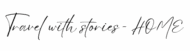⏱️ Pas le temps ? Voici Istanbul au XVIIIe siècle en 1 minute :
💥 Une ville en crise et en mouvement
Istanbul traverse un siècle agité : incendies, révoltes, réformes avortées. Mais elle tient bon, se réorganise, et se transforme sans cesse.
🌷 Des fastes de l’ère des Tulipes aux réformes de Selim III
Fontaines impériales, fêtes raffinées, casernes modernisées : le pouvoir tente de reprendre la main entre architecture baroque et inspirations venues d’Europe.
📍 Des quartiers recomposés, un urbanisme réinventé
Les élites fuient le centre pour les rives du Bosphore. De nouveaux lieux émergent : Selimiye, Beylerbeyi, Fener, Emirgan. L’Istanbul ottomane se redessine.
🕌 Ce qu’il en reste aujourd’hui
Des mosquées méconnues, des fontaines baroques, des ruelles à explorer autrement : l’Istanbul du XVIIIe siècle est là, sous vos pas, si vous savez où regarder.
👉 Envie de creuser ? Lisez l’article complet pour plonger dans un siècle instable mais fascinant.
Le XVIIIe siècle n’est pas un âge d’or pour Istanbul. C’est un siècle de tensions, de tentatives, de ruptures. Une ville immense, saturée, où le feu, la maladie et les déséquilibres démographiques bousculent sans cesse l’ordre établi.
Le pouvoir tente d’y répondre. Par le faste, d’abord : fontaines publiques, fêtes impériales, jardins au bord de l’eau. Par la réforme ensuite : écoles, casernes, imprimeries, bibliothèques. Mais chaque projet se heurte à des résistances, chaque ambition finit par se briser.
À chaque moment du siècle, Istanbul donne l’impression d’être en déséquilibre. Quartiers reconstruits, populations déplacées, projets abandonnés. Et pourtant, la ville tient. Elle absorbe les chocs, change de visage, se réorganise sans cesse — sans jamais vraiment se stabiliser.
Ce récit suit le fil de ces tensions, en retraçant la transformation progressive d’Istanbul : ses quartiers, ses bâtiments, ses équilibres sociaux.
I) 1700–1730 – Istanbul sous pression : foule, feu, fêtes
👥 Une ville saturée : population, diversité, instabilité
Au début du XVIIIe siècle, Istanbul rassemble environ 500 000 habitants. Ce chiffre impressionnant reflète l’attractivité de la capitale impériale, mais aussi sa fragilité. La croissance naturelle est freinée par les crises : incendies meurtriers, épidémies récurrentes, conditions de vie précaires.
La population se renouvelle en continu, portée par les migrations venues des campagnes, souvent touchées par la guerre ou l’insécurité. Ces mouvements alimentent les faubourgs et renforcent la diversité sociale et religieuse de la ville.
La répartition confessionnelle semble se stabiliser après des fluctuations marquées aux siècles précédents. On estime qu’environ 60 % des habitants sont musulmans, 40 % chrétiens — un équilibre instable, sans cesse réajusté au fil des départs, des réinstallations et des politiques impériales.
🏘️ Un tissu urbain sous tension : habitat densifié, centre recomposé
Istanbul ne s’étend pas : elle se densifie. Au début du siècle, la ville se transforme plus par empilement que par expansion. Les grandes propriétés du centre, souvent abandonnées par les élites après un incendie ou une épidémie, sont morcelées, reconstruites, loties. On y voit apparaître de petites maisons, des chambres pour célibataires ou migrants, des immeubles modestes construits sur des terrains jadis occupés par des jardins.
Cette densification modifie l’apparence même de l’habitat. Les maisons gagnent en hauteur, les façades s’ouvrent davantage sur la rue, les cours intérieures se réduisent. En 1707, une réforme autorise la construction de deux étages : un tournant discret, mais révélateur d’une ville qui change ses usages pour mieux absorber ses nouveaux habitants.
Dans le même temps, les élites quittent progressivement le centre pour s’installer sur les rives du Bosphore, dans des palais ou des demeures plus aérées. Le cœur historique d’Istanbul devient plus populaire, plus dense, plus vulnérable aussi — mais capable de se réinventer après chaque crise.
✨ Certaines traces de ces transformations sont encore visibles aujourd’hui : dans les ruelles étroites de Zeyrek, Balat ou Kasımpaşa, on trouve encore des maisons en bois à encorbellement, étagées sur deux niveaux, souvent reconstruites sur les anciennes parcelles incendiées. Leur organisation — façades sur rue, cours réduites à l’arrière — conserve l’empreinte de cette époque où la ville se recomposait après chaque choc.
🔍 Voir des exemples en images :
- 🏠 Maisons traditionnelles à Balat (Dreamstime)
- 🏠 Maisons anciennes à Zeyrek (Alamy)
- 🏠 Maisons en bois à Kasımpaşa (Alamy)
🌷 Faste impérial et illusions : l’ère des Tulipes
Entre 1718 et 1730, ce qu’on appelle “l’ère des Tulipes” marque une parenthèse de raffinement dans l’histoire mouvementée d’Istanbul. Sous l’impulsion d’Ahmet III et de son grand vizir Ibrahim Pacha, le pouvoir tente de répondre à l’instabilité par la beauté.
Le cœur du projet se joue dans l’espace public : pavillons, bibliothèques, jardins, mais surtout fontaines monumentales — comme celle d’Ahmet III, toujours visible à l’entrée de Topkapi. L’urbanisme devient un langage politique. On met en scène l’ordre, la prospérité, le bon goût.
Le faste culmine dans les fêtes impériales de Kâğıthane, organisées au bord des “Eaux douces de l’Europe”, dans une nature aménagée pour la célébration. Le sultan et son entourage fuient les désordres du centre et se tournent vers les rives, plus aérées, plus sûres, plus symboliques.
Mais la réalité rattrape rapidement l’apparence. En 1718, un incendie majeur ravage une partie de la ville, cinq jours avant la signature du traité de Passarowitz. La population s’agace des dépenses somptuaires. En 1730, la révolte de Patrona Halil met fin à cette séquence. L’ère des Tulipes est effacée en quelques jours. Mais ses traces demeurent, dans certaines formes, certains lieux, certaines fêtes.
📍 Voir aujourd’hui :
- 👉 Fontaine d’Ahmet III – Topkapi (photo)
- 👉 Kâğıthane – Eaux douces de l’Europe (lieu des fêtes impériales)
- 👉 Palais de Beylerbeyi – site historique des rives impériales
II ) 1730–1750 – Révoltes et reconstructions
🧨 Révolte de 1730 : chute du sultan, effacement des fastes
En 1730, l’ère des Tulipes s’effondre brutalement. La révolte de Patrona Halil, soutenue par les janissaires, éclate à Istanbul et contraint le sultan Ahmet III à abdiquer. En quelques jours, les symboles du faste impérial sont détruits ou abandonnés. Le pouvoir, fragilisé, doit reconstruire. Mais il le fait autrement : sans renoncer à l’apparat, mais en réorientant son langage architectural.
🏗️ Reprise édilitaire prudente : petits édifices, nouvelles intentions
C’est dans cette période de transition que se dessinent les premières expressions du baroque ottoman. Ce style introduit des formes plus souples : façades polylobées, courbes fluides, décors végétaux en relief. Il s’éloigne de la sobriété géométrique des siècles précédents, sans renier les fondements de l’architecture ottomane : coupole centrale, plan symétrique, minaret unique, distribution autour d’une cour à portique.
Ce renouveau s’exprime d’abord dans les sebils et les bibliothèques, des bâtiments civils de petite taille, plus libres dans leur conception.
📚 Début du baroque ottoman : entre rupture et continuité
À Süleymaniye, la bibliothèque Atıf Efendi, fondée en 1741, conserve une façade discrète mais propose un agencement intérieur inédit : une salle semi-circulaire avec des niches de lecture individuelles, comme dans une chapelle. Le plan circulaire rompt avec l’organisation rectiligne traditionnelle . Plus au sud, la mosquée Hekimoğlu Ali Paşa, construite entre 1732 et 1735, reprend un plan classique — une grande coupole centrale sur baldaquin hexagonal, précédée d’une cour à arcades — mais s’enrichit d’un sebil d’angle : auvent circulaire, motifs végétaux en accolade, grille ondulée. En 1741, Mehmet Emin Ağa, officier sans rang élevé, fait construire un sebil encore plus audacieux, sans arcades classiques reliant les colonnes, avec un décor de volutes, frises et bandeaux superposés.
Ces bâtiments racontent une autre manière de penser la reconstruction : moins monumentale, mais plus inventive, plus ornementée, plus expérimentale. Loin de la grandiloquence de l’ère des Tulipes, Istanbul entre dans une période d’exploration de nouvelles formes, où la tradition s’adapte sans se renier.
III) 1750–1780 – Vers les rives, vers l’Europe
🕌 Nuruosmaniye : manifeste d’un nouveau style
En 1755, la mosquée de Nuruosmaniye est inaugurée à l’entrée du Grand Bazar, dans le quartier animé de Çemberlitaş. C’est la première mosquée impériale construite depuis plus d’un demi-siècle — mais son style marque une rupture nette avec la tradition. Sa coupole légèrement ovale, son plan à pendentif (où la coupole repose sur quatre arcs pour former une transition souple entre carré et cercle), et ses décorations baroques en font un bâtiment à part dans le paysage stambouliote.
Le style classique hérité de l’architecte Mimar Sinan, maître bâtisseur du XVIe siècle, reposait sur l’équilibre, la symétrie, des volumes sobres, des arcs brisés, des chapiteaux géométriques. La mosquée de Nuruosmaniye s’en éloigne : les façades présentent des motifs végétaux en relief, les grilles des fenêtres adoptent des formes ondulées, les colonnades de la cour se déploient en demi-cercle autour d’un espace central en fer à cheval. Ce dernier, visible encore aujourd’hui, donne une impression d’enveloppement et de fluidité très différente des grandes cours rectangulaires classiques.
La lumière joue un rôle central dans cette nouvelle esthétique. De larges baies sont ouvertes sur la coupole, encadrées par des volutes et des ornements sculptés. L’effet recherché est celui d’un intérieur clair, presque théâtral, très éloigné de la pénombre majestueuse des mosquées classiques comme Süleymaniye.
La construction de Nuruosmaniye est aussi un geste politique. Le pouvoir impérial choisit de bâtir cette mosquée au cœur du centre marchand, là où les flux économiques sont les plus denses. Située juste au-dessus de l’entrée principale du Grand Bazar, elle s’impose dans le paysage urbain comme un symbole de stabilité et de renouveau. Pour un visiteur, c’est aujourd’hui encore l’une des premières mosquées visibles depuis la rue commerçante de Divanyolu.
📍 À voir aujourd’hui :
- Mosquée Nuruosmaniye, quartier Çemberlitaş (entrée du Grand Bazar)
Lien Google Maps
👉 Cour à colonnades incurvées (côté nord)
👉 Intérieur très lumineux, décor végétal, coupole ovale
👉 Fontaine d’ablution monumentale dans la cour
L’influence européenne s’affirme
À partir du milieu du XVIIIe siècle, les élites ottomanes commencent à regarder ouvertement vers l’Occident. L’ambassade de France à Istanbul devient un relais d’inspiration majeur. En 1720, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, un diplomate ottoman envoyé à Paris par Ahmet III, découvre Versailles, Fontainebleau, et les jardins de Marly. À son retour, ses récits circulent dans les cercles du pouvoir et déclenchent une véritable curiosité pour l’architecture et le mode de vie français.
Dans les décennies suivantes, des architectes européens sont invités à Istanbul. Le plus notable est Vigné de Vigny, mandaté pour reconstruire l’ambassade de France après un incendie. Il introduit un style inspiré du rococo français, que l’on retrouve dans certains pavillons de la cour ottomane, comme ceux édifiés à Sa’dabad (à Kâğıthane) ou Beylerbeyi, ainsi que dans des résidences de dignitaires, notamment le manoir de Hekimoğlu Ali Paşa ou des kiosques privés situés en bordure du Bosphore.
Dans les décennies suivantes, de nombreux bâtiments civils adoptent ce nouveau langage architectural : façades animées (avec des avancées, des décrochements, des moulures), surfaces ornées de motifs végétaux sculptés, fenêtres encadrées de boiseries finement découpées, ce que l’on appellera les “dentelles de bois”.
Des exemples de ces influences sont encore visibles aujourd’hui :
- Le sebil de Mehmet Emin Ağa, construit en 1741 près de Dolmabahçe, présente des grilles en volutes, un auvent circulaire, et un décor floral typiquement rococo.
- Les pavillons de plaisance le long du Bosphore, comme les parties anciennes du palais de Beylerbeyi, adoptent des lignes plus souples, des fenêtres élargies, et des consoles sculptées.
- Certaines fontaines monumentales, comme celle de Mahmud Ier à Tophane, mélangent inspirations baroques et décors ottomans.
Cette influence reste d’abord cantonnée aux édifices civils et aux résidences secondaires : les mosquées conservent, jusqu’aux années 1760, une certaine rigueur classique. C’est à la fois une question de tradition religieuse, et de prudence politique : le style occidental reste associé à la sphère privée, à la cour, voire à un art de vivre réservé à une élite.
Le style européen n’est donc pas copié, mais partiellement absorbé. Il s’ajuste aux formes locales, aux matériaux disponibles, à l’organisation urbaine d’Istanbul. Il donne naissance à une esthétique hybride, à la fois familière et nouvelle — et qui annonce les grandes innovations de la fin du siècle.
📍 À voir aujourd’hui :
- Sebil Mehmet Emin Ağa (quartier Dolmabahçe) – motifs floraux, arcades courbes, style rococo
- Palais de Beylerbeyi (rive asiatique) – pavillons anciens à inspiration française
- Fontaine de Mahmud Ier à Tophane – exemple d’influence baroque dans un décor ottoman
🧭 La hiérarchie urbaine se recompose
Au XVIIIe siècle, la géographie sociale d’Istanbul change. Loin d’être figée, la ville évolue au rythme des déplacements de population, des bouleversements économiques, et des reconquêtes territoriales. Les quartiers se redéfinissent, les communautés se déplacent, et une nouvelle carte sociale se dessine progressivement.
Un premier glissement s’opère dès la fin du XVIIe siècle avec le déclin de la communauté juive dans le centre commerçant de la ville. Ce recul commence avec le projet de construction de la mosquée Yeni Valide, initié par Safiye Sultane, et s’achève en 1663. Les Juifs, jusqu’alors présents au cœur des zones de négoce, sont progressivement évincés. Ils se replient à Hasköy, sur la rive nord de la Corne d’Or, dans une zone enclavée entre les anciens territoires génois et vénitiens. Le quartier conserve aujourd’hui quelques traces de cette histoire, notamment avec la synagogue Karaite de Hasköy, fondée par une branche ancienne du judaïsme.
Dans le même temps, le vide laissé dans la sphère financière est comblé par les Arméniens, qui prennent une place croissante dans les affaires fiscales de l’Empire, tandis que les Grecs orthodoxes — les fameux Phanariotes — s’imposent dans le commerce. Le quartier de Fener, où réside le patriarche orthodoxe, devient le centre de gravité de cette nouvelle aristocratie grecque. On peut encore y voir aujourd’hui les grandes maisons patriciennes de brique rouge, notamment le lycée grec orthodoxe qui domine la colline et incarne visuellement la puissance symbolique de cette communauté.
À l’ouest de Fener, la zone de Galata, ancien comptoir génois, accueille depuis le XVIe siècle les communautés européennes établies à Istanbul. À partir des années 1560, les ambassadeurs de France, de Venise, puis d’Angleterre et de Hollande s’installent sur les hauteurs, dans le quartier de Pera. Ce secteur devient le cœur battant de la présence occidentale dans la ville. On y trouve des églises catholiques, des écoles étrangères, et des palais d’ambassade bâtis dans un style occidental. Ce mélange attire une population urbaine nouvelle : des chrétiens locaux, souvent employés comme intermédiaires ou interprètes auprès des Européens. Pour eux, monter à Pera, c’est gravir l’échelle sociale.
En parallèle, une nouvelle dynamique s’installe autour du Bosphore, qui attire progressivement les classes aisées musulmanes. Les élites quittent les quartiers surpeuplés du centre pour construire des demeures sur les rives, dans des zones plus aérées, entrecoupées de forêts, d’eaux douces et de résidences impériales. Ce phénomène — amorcé avec la fuite des notables après les grands incendies — donne naissance à un nouvel espace résidentiel, visible aujourd’hui encore dans des villages comme Beylerbeyi, Üsküdar, ou Emirgan, où subsistent des yalıs (maisons ottomanes en bois) datant du XVIIIe siècle.
📍 À voir aujourd’hui :
- Fener : lycée grec orthodoxe, maisons de Phanariotes, Patriarcat œcuménique
- Hasköy : vestiges du quartier juif, synagogue Karaite (restaurée)
- Pera / Galata : anciennes ambassades, rue Istiklal, églises et palais européens
- Beylerbeyi & Emirgan : yalıs du XVIIIe siècle, anciens quartiers d’été des élites ottomanes
IV) 1780–1807 – La réforme impossible
📚 Selim III et l’ambition d’un ordre nouveau
Quand Selim III monte sur le trône en 1789, la capitale est en crise. Istanbul est submergée par les réfugiés venus des provinces perdues, frappée par la misère, les épidémies, les pillages. Le jeune sultan hérite d’un empire affaibli, désorganisé, au bord de l’effondrement. Conscient du décalage croissant avec les puissances européennes, il veut tout reprendre à la racine — à commencer par l’armée.
Il crée un corps militaire nouveau, le Nizam-i Cedid (“ordre nouveau”), formé et équipé selon les standards européens. Mais la réforme ne s’arrête pas là : elle s’inscrit dans une volonté plus large de moderniser l’État, ses outils, sa présence dans la ville. Pour observer les puissances étrangères, Selim III fonde des ambassades permanentes à Londres, Vienne ou Paris, chargées de ramener des idées, des techniques, des modèles d’organisation.
Son grand chantier symbolique, c’est le nouveau quartier de Selimiye, sur la rive asiatique du Bosphore, à Üsküdar. Conçu comme un laboratoire de la réforme, il rassemble une caserne monumentale, une mosquée impériale, une soupe populaire, et l’imprimerie Müteferrika. Il veut y établir un véritable pôle d’innovation — un nouveau centre, tourné vers la réforme, l’efficience, la technique. L’endroit est choisi pour sa position stratégique : assez éloigné du cœur conservateur d’Istanbul pour éviter les frictions, mais encore visible, comme un signal vers l’avenir.
Cette volonté de réforme se double d’une posture personnelle : Selim sillonne la ville incognito, constate lui-même les abus, tente de rétablir l’équilibre par la morale autant que par les institutions. En 1793, il fait fondre les objets en or du palais — jusqu’aux bijoux des odalisques — pour frapper de la monnaie et relancer les finances publiques. Il incarne une forme de despotisme éclairé, proche de l’esprit des Lumières européennes, mais enraciné dans la tradition impériale ottomane.
📍 À voir aujourd’hui :
- Caserne de Selimiye (quartier Selimiye, Üsküdar) : immense bâtiment militaire du tournant du XIXe, toujours debout
- Mosquée Selimiye (1801–1805) : architecture de transition, quartier en damier visible dans l’urbanisme
- Quartier Selimiye : promenade possible entre caserne, mosquée et reste du tissu réformé du XIXe siècle
💥 Les résistances : quand la ville se braque
Face aux réformes de Selim III, les oppositions se cristallisent rapidement. Plusieurs groupes redoutent les bouleversements : les janissaires, pilier de l’armée ottomane depuis des siècles ; les religieux, défenseurs de l’ordre traditionnel ; et les notables provinciaux, attachés à leur autonomie locale. Tous craignent de perdre leurs privilèges.
Les janissaires, autrefois élite redoutée, sont devenus une force conservatrice bien ancrée dans la ville. Ils occupent des postes dans les corporations artisanales (comme les bouchers, les boulangers ou les porteurs d’eau), imposent leurs hommes à des fonctions clés, et exercent une forme de tutelle sur certaines professions. Ils s’installent aussi dans les quartiers populaires, où leur présence physique — casernes, logements collectifs — mais aussi leur influence quotidienne leur permet de faire pression sur les habitants, d’accorder des protections, ou de mener des représailles en cas de conflit. Ils ne sont pas seulement soldats : ils vivent dans la ville, organisent des processions, interviennent dans des litiges, et participent aux célébrations publiques. Leur influence déborde largement du domaine militaire. L’arrivée d’une armée parallèle, le Nizam-i Cedid, formée à l’européenne, les alarme : ils y voient un affront direct à leur statut. Pour comprendre leur rôle, on peut visiter le Musée militaire d’Istanbul (Harbiye Müzesi), qui expose leurs costumes, instruments de musique, et leur place dans la culture impériale.
Mais la résistance ne vient pas que de l’armée. Les religieux, formés dans les grandes medrese du centre, s’inquiètent de la diffusion d’ouvrages laïques imprimés à l’imprimerie impériale, aujourd’hui disparue mais autrefois installée dans le quartier de Selimiye. Ils voient aussi d’un mauvais œil la création d’écoles militaires modernes, comme celle des ingénieurs de la marine, qui échappent à leur contrôle. Ces projets sont perçus comme une occidentalisation rampante, une remise en cause du cadre islamique.
Les notables provinciaux, eux, veulent préserver leur pouvoir local. Alors que l’Empire perd du terrain face à la Russie et à l’Autriche, certains rêvent de renforcer leur emprise sur les campagnes proches d’Istanbul ou les provinces des Balkans. Mais les réformes de Selim visent à centraliser l’administration, à reprendre la main sur les impôts et les fonctions locales — une menace directe pour leurs ambitions.
Dans la ville, la grogne monte. Pour financer les réformes, il faut lever des taxes. Les migrants venus des provinces, souvent des ruraux chassés par la guerre ou les crises agricoles, s’entassent dans des faubourgs périphériques comme Eyüp, Kasimpasa. Ces quartiers, mal intégrés aux circuits officiels de ravitaillement ou de sécurité, deviennent des foyers de mécontentement. Les corps de métier traditionnels, souvent protégés par les janissaires, se voient bousculés par les nouvelles réglementations. Beaucoup craignent de perdre leur statut, leur clientèle ou leur rôle dans la ville.
Le fossé se creuse : d’un côté, le vieux centre historique, saturé et méfiant face au changement ; de l’autre, des zones nouvelles comme Selimiye, plus ouvertes, plus organisées, mais jugées étrangères à l’esprit d’Istanbul.
📍 À voir aujourd’hui :
- Musée militaire d’Istanbul (Harbiye Müzesi) : salle des janissaires, instruments de musique, costumes
- Quartier de Selimiye (Üsküdar) : caserne, mosquée, traces du projet réformateur
- Quartiers anciens comme Fatih, Eyüp ou Kasimpasa : bastions traditionnels, traces de medrese
- Mosquées du centre : témoins de l’ordre ancien, toujours en usage
🔥 Crises terminales : incendies, révolte et fin de règne
À la fin du XVIIIe siècle, la tension monte d’un cran dans la capitale ottomane. La réforme portée par Selim III peine à convaincre. L’ordre ancien, affaibli mais encore puissant, résiste. Et les catastrophes naturelles viennent aggraver le climat.
En 1782, un gigantesque incendie ravage Istanbul. Il dure plusieurs jours et détruit une grande partie des quartiers en bois du centre, notamment autour du quartier de Fatih et de la mosquée éponyme, déjà plusieurs fois reconstruite dans l’histoire. Cette catastrophe, la plus violente depuis deux siècles, renforce le sentiment d’une ville à bout de souffle. La population, épuisée, voit d’un mauvais œil les dépenses impériales et les projets de réforme.
Les tensions atteignent leur paroxysme en 1807. Selim III, toujours décidé à moderniser l’armée, veut étendre le recrutement du Nizam-i Cedid à la Roumélie. Les janissaires, soutenus par une partie du clergé et des notables, se soulèvent. La révolte part du Bosphore, menée par la milice chargée de défendre le détroit. Elle gagne rapidement le cœur de la ville. Selim est déposé, puis assassiné l’année suivante. C’est la fin brutale de son règne.
Dans les jours qui suivent, Istanbul sombre dans le chaos. Des milices rivales prennent le contrôle de certains quartiers, des pillages ont lieu, les bâtiments associés aux réformes sont visés. Le projet de Selimiye, à Üsküdar, est interrompu. Les quartiers périphériques comme Kasimpasa deviennent des refuges pour les mécontents, des foyers de violences. Dans le centre historique, c’est l’ordre ancien qui reprend la main, au prix de destructions massives.
Aujourd’hui, ces événements laissent peu de traces visibles, mais leurs échos se devinent. La mosquée Fatih, reconstruite une nouvelle fois au XIXe siècle, symbolise cette résilience entre effondrement et renaissance. Le musée militaire d’Istanbul (Harbiye) permet de comprendre le rôle des janissaires, leur poids dans la société et leur chute. Et du côté d’Eyüp Sultan, haut lieu spirituel et politique, on peut encore sentir l’atmosphère d’une ville prise entre ferveur religieuse et crise politique.
📍 À voir aujourd’hui :
- Mosquée Fatih : reconstruite après le séisme et les incendies
- Musée militaire d’Istanbul (Harbiye) : armée ottomane, janissaires, crise militaire
- Quartier de Kasimpasa : ancrage populaire, périphérie agitée à la fin du XVIIIe
- Eyüp Sultan : haut lieu symbolique, toujours actif
- Üsküdar – Selimiye : traces du projet interrompu, caserne et mosquée toujours debout
🛠️ Reconstruire après la crise : Mahmut II et la fin du siècle
Lorsque Mahmut II monte sur le trône en 1808, il est le dernier membre survivant de la dynastie ottomane. Istanbul sort à peine des révoltes, des incendies, et de l’anarchie. Le pouvoir est affaibli, les réformes suspendues, et la ville fracturée entre ses bastions traditionnels et ses quartiers neufs à peine éclos. Mais plutôt que de relancer un programme ambitieux comme celui de Selim III, Mahmut avance prudemment. Il cherche à reconstruire sans provoquer, à restaurer l’ordre sans effrayer.
Les grands chantiers de cette période ne sont plus des casernes, mais des édifices religieux et utilitaires. Deux mosquées impériales sont construites hors du centre historique, loin des tensions : l’une à Beylerbeyi, sur la rive asiatique du Bosphore, en 1777 (Mosquée Hamid-i Evvel) ; l’autre à Emirgan, sur la rive européenne, en 1781 (Mosquée de l’émirgan Hamid-i Sani). Ces choix marquent une volonté de décentrer la présence impériale, de la rapprocher de la cour et de ses nouvelles résidences, tout en évitant les zones de friction. Ces deux mosquées se visitent encore aujourd’hui, en marge des circuits classiques, et offrent un point de vue intéressant sur l’architecture ottomane tardive, sobre mais élégante.
Dans le quartier de Selimiye, Mahmut II relance le projet entamé par Selim III : il achève la caserne de Selimiye, fait construire la mosquée impériale de Selimiye (1801–1805), et accueille à nouveau l’imprimerie impériale, déplacée plusieurs fois depuis sa création. La mosquée est toujours visible aujourd’hui, et bien que peu fréquentée par les visiteurs, elle constitue une étape intéressante pour comprendre l’ambition urbanistique de cette période. Le quartier devient un centre d’expérimentation réformiste à petite échelle. Le style reste classique — comme en témoignent la caserne elle-même ou la mosquée, avec leur plan régulier, leurs volumes sobres et leur absence de décor exubérant — mais les infrastructures sont pensées pour être fonctionnelles, adaptées à une capitale moderne. Encore visible aujourd’hui, le quartier de Selimiye illustre ce que l’Empire aurait pu devenir, sans l’effondrement politique qui suivra.
Ce mouvement vers la périphérie s’accompagne aussi de grands travaux d’aménagement : fontaines, barrages, redistribution de l’eau. Dans les forêts au nord de la ville, des barrages maçonnés sont construits ou rénovés, notamment le Topuzlu Bend, pensé comme un lieu d’agrément autant qu’un ouvrage hydraulique. Ce type de réalisation reflète une approche plus technique, plus pratique du pouvoir, qui cherche à restaurer la légitimité impériale par l’utilité et la stabilité.
Mahmut II ne réforme pas l’armée — du moins, pas encore. Il attendra les années 1820 pour s’y attaquer frontalement. Mais il réinstalle progressivement les marqueurs d’un pouvoir stable, sans affronter de front les résistances. Istanbul, à la veille du XIXe siècle, ne brille pas comme au temps de Soliman le Magnifique, qui avait fait construire la mosquée Süleymaniye et incarnait l’âge d’or de l’Empire au XVIe siècle ; ni comme sous Ahmet III, dont les fêtes somptueuses et les pavillons de l’ère des Tulipes avaient marqué un âge du raffinement. Mais elle se maintient : une capitale encore blessée, mais réorganisée, recentrée, prête à renaître.
📍 À voir aujourd’hui :
- Mosquée Hamid-i Evvel (Beylerbeyi) : architecture impériale sobre, vue sur le Bosphore
- Mosquée Hamid-i Sani (Emirgan) : bel exemple d’équilibre entre monumentalité et discrétion
- Quartier de Selimiye (Üsküdar) : caserne, mosquée impériale, tracé régulier du quartier neuf
- Topuzlu Bend (forêt de Belgrad) : barrage du XVIIIe siècle, balade possible dans les bois
- Fontaines de Mahmut II (Tophane, Kabataş) : dernières grandes œuvres hydrauliques de la période
🧭 Conclusion – Ce que le XVIIIe siècle a laissé
Le XVIIIe siècle n’a pas offert à Istanbul un âge d’or. Mais il a profondément marqué la ville que l’on parcourt aujourd’hui. Les réformes inabouties, les catastrophes à répétition et les ambitions architecturales ont laissé leur empreinte dans les quartiers comme Selimiye, Fener ou Beylerbeyi. Le centre de gravité de la capitale s’est déplacé : les élites ont quitté la vieille ville pour les rives du Bosphore, et les nouvelles constructions ont transformé la physionomie des faubourgs.
Autrefois structurée autour de complexes religieux aux grands jardins intérieurs, comme à Süleymaniye, la ville s’oriente alors vers un habitat plus dense, plus pratique, où l’on bâtit en hauteur, en mitoyenneté, et parfois sans cour.
Les mosquées de Nuruosmaniye, Selimiye ou Emirgan racontent cette transition, entre architecture ottomane classique et baroque tardif. Dans des lieux plus discrets — comme le sebil de Mehmet Emin Ağa près de Dolmabahçe, la bibliothèque Atıf Efendi à Süleymaniye ou les ruelles quadrillées de Selimiye —, on perçoit les efforts plus modestes mais bien réels pour moderniser l’Empire sans rompre avec ses fondements.
Explorer cette Istanbul du XVIIIe siècle, c’est comprendre une capitale en mouvement, prise entre la tradition et le changement. C’est aussi regarder autrement les quartiers à visiter à Istanbul : ne plus seulement admirer les monuments, mais les lire comme des récits en pierre. Les rives du Bosphore, les faubourgs d’Üsküdar, les pentes de Galata ou les rues anciennes de Fatih deviennent autant de fragments d’un siècle instable, mais fondateur.
Le XVIIIe siècle n’a peut-être pas produit de chef-d’œuvre univoque. Mais il a semé les traces d’une Istanbul ottomane encore visible — pour peu qu’on prenne le temps de les chercher, au-delà des itinéraires classiques.
🔗 À explorer sur le blog :
👉 La fontaine d’Ahmet III à Topkapi
👉 Nuruosmaniye, la première mosquée baroque d’Istanbul
👉 Selimiye : un quartier né de la réforme ottomane (1800–1807)
👉 Réformer l’Empire par la caserne : histoire du complexe de Selimiye à Üsküdar
👉 Itinéraire baroque : 5 lieux pour découvrir l’architecture ottomane autrement