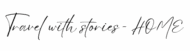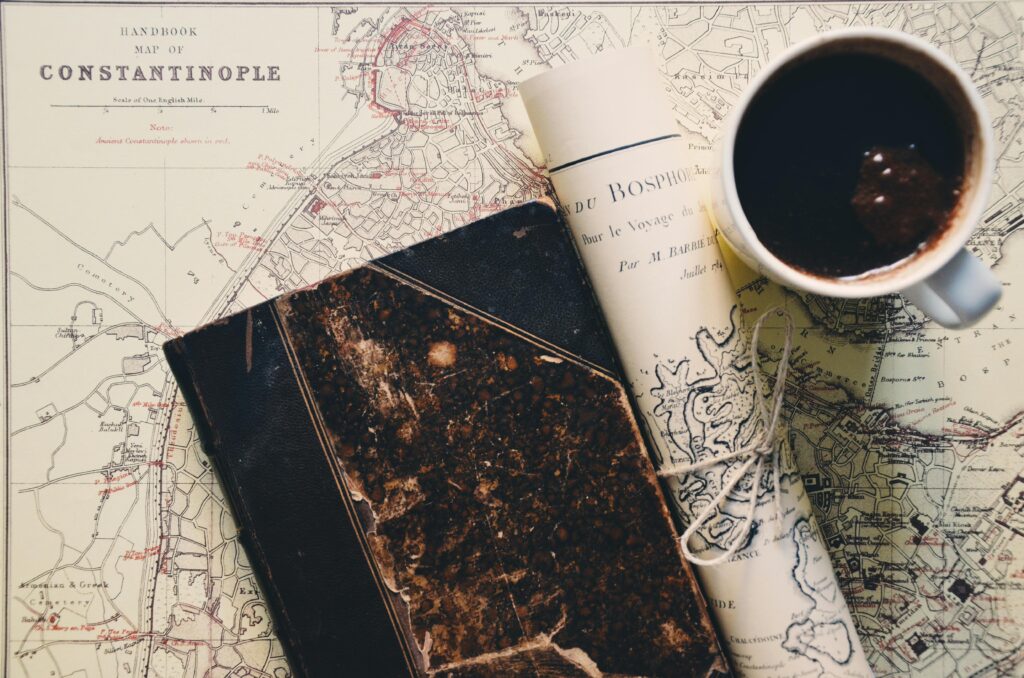De Rome à Byzance – Une balade dans la ville fondatrice de l’Orient
Au tournant du IVᵉ siècle, un événement va bouleverser la carte du monde antique : la fondation de Constantinople, une nouvelle capitale voulue par un empereur en quête d’un pouvoir centralisé et d’un territoire stabilisé.
Byzance, ville modeste perchée sur les rives du Bosphore, devient Constantinople — la “Nouvelle Rome”, berceau de l’actuelle Istanbul. Plus qu’un simple déplacement de capitale, c’est un geste politique fondateur, une projection impériale vers l’Orient, qui marque un tournant décisif dans l’histoire romaine, l’histoire chrétienne et l’histoire du monde antique.
Ce récit vous propose une balade historique à Constantinople à travers les grandes étapes de la construction de la ville sous l’empereur Constantin et ses successeurs : entre vision stratégique, urbanisme romain, lieux de pouvoir et vie quotidienne. Une invitation à comprendre comment, en quelques décennies, une ville secondaire est devenue le cœur battant de l’Empire byzantin, qui allait durer plus de mille ans et dont l’héritage est encore visible dans les rues d’Istanbul.
Commençons notre visite au Million, pour comprendre le contexte de la fondation.
 I. Fonder une Nouvelle Rome : le projet de Constantin
I. Fonder une Nouvelle Rome : le projet de Constantin
1. Crise de l’Empire et quête de stabilité
 Affaiblissement de Rome au IIIᵉ siècle
Affaiblissement de Rome au IIIᵉ siècle
Depuis le IIIᵉ siècle, Rome, affaiblie par des crises internes et des pressions extérieures, perd progressivement son rôle de capitale impériale. Les empereurs préfèrent alors s’installer dans des villes provinciales stratégiques, comme Milan ou Nicomédie, proches des frontières où se joue l’avenir de l’Empire : barbares à l’ouest, Perses à l’est.
 Tétrarchie de Dioclétien, victoire sur Licinius puis réunification par Constantin
Tétrarchie de Dioclétien, victoire sur Licinius puis réunification par Constantin
En 293, pour mieux gouverner son vaste territoire, Dioclétien instaure la tétrarchie, un système qui partage le pouvoir entre quatre empereurs. Mais ce fragile équilibre dégénère en luttes de pouvoir. En 324, après des années de rivalité, Constantin défait Licinius lors de la bataille de Chrysopolis, devenant ainsi le seul maître de l’Empire romain.
L’unité est restaurée, même si elle sera de nouveau remise en cause après la division de 395 sous Théodose Ier. Pour l’heure, Constantin entreprend de consolider son pouvoir et de lui donner un nouveau cœur.
2. Le choix de Byzance
 Une fondation impériale : Constantin, fondateur d’une “Nouvelle Rome”
Une fondation impériale : Constantin, fondateur d’une “Nouvelle Rome”
En novembre 324, Constantin décide de fonder une nouvelle capitale impériale : une “Nouvelle Rome”. Ce choix est d’abord symbolique : il affirme la puissance retrouvée de l’Empire et marque un basculement stratégique vers l’Orient.
 Une position stratégique
Une position stratégique
Son choix se porte sur Byzance, une ville déjà existante mais idéalement située :
- à l’écart des grands axes d’invasion,
- assez proche des frontières pour permettre une réaction rapide,
- au croisement de grandes routes impériales comme la voie Égnatia et la route de Sirmium, assurant des liaisons rapides entre Occident et Orient.
 Inauguration solennelle de Constantinople (330)
Inauguration solennelle de Constantinople (330)
En mai 330, a lieu la cérémonie d’inauguration de la ville. Des processions impériales traversent la Mésè, l’artère principale, et la ville prend officiellement le nom de son fondateur : Constantinople.
3. Une capitale romaine en construction
 Triplement de la superficie
Triplement de la superficie
Constantin entreprend de tripler la superficie de Byzance. Il engage de vastes travaux d’urbanisation pour en faire une véritable capitale impériale. Le projet mobilise d’importantes ressources fiscales et bénéficie aussi des confiscations des revenus des temples païens, dans un contexte de christianisation progressive de l’Empire.
 Plan structuré autour de la Mésè
Plan structuré autour de la Mésè
Le plan de la ville s’organise autour de la Mésè, l’artère principale (actuelle Divan Yolu Caddesi à Istanbul) qui relie les grands sites de la capitale. Elle commence au Million, point de départ officiel pour mesurer les distances dans l’Empire, devant lequel nous nous trouvons. Ce vestige antique se situe aujourd’hui dans le quartier historique de Sultanahmet. Rendons-nous maintenant au cœur du pouvoir impérial.
 II. Incarner l’Empire à Constantinople
II. Incarner l’Empire à Constantinople
Pour mieux comprendre le projet impérial de Constantin, dirigeons-nous vers le quartier impérial, là où se trouvaient le Grand Palais, l’Hippodrome et l’Augustaion.
1.  Le Grand Palais : résidence et centre du pouvoir
Le Grand Palais : résidence et centre du pouvoir
À l’emplacement de l’actuelle mosquée Sultan Ahmet (la fameuse mosquée bleue) se trouvait autrefois le Grand Palais, ou “Palais Sacré”. Véritable cœur du pouvoir impérial, il fut le siège de la cour et de l’administration jusqu’au règne d’Alexis Comnène (1081–1118).
Le palais n’est pas un simple bâtiment, mais un vaste complexe mêlant cours, jardins, galeries et églises interconnectées, s’étendant entre l’Hippodrome et la mer. Commencé sous Constantin, il est achevé par son fils Constance II (337–361) et remanié jusqu’au Xe siècle.
On y accédait par une porte monumentale, la Chalkè. Il abritait plusieurs édifices majeurs :
- le palais de Daphné, résidence privée de l’empereur,
- la Magnaure et le Chrysotriclinium, pour les réceptions officielles.
Il communiquait directement avec l’Hippodrome via une loge impériale appelée kathisma, adossée aux gradins.
2.  L’Augustaion : la place sacrée du pouvoir
L’Augustaion : la place sacrée du pouvoir
Non loin de là, à l’emplacement de l’actuelle Ayasofya Meydanı, s’étendait l’Augustaion, grande place impériale de Constantinople. Elle portait à l’origine le nom de Tetrastoon, “place à quatre portiques”, une forme héritée des cités gréco-romaines.
Constantin la rebaptise pour honorer sa mère Hélène, devenue Augusta. Contrairement aux forums antiques ouverts, l’Augustaion est un espace monumental fermé, réservé aux élites. Des statues colossales de l’empereur et de sa famille y sont érigées. Toucher à ces statues équivaut à un crime contre l’empereur lui-même.
La place relie trois pôles essentiels : le Grand Palais, le Sénat et Sainte-Sophie. Lors des grandes cérémonies, l’empereur traverse l’Augustaion, incarnant à la fois le chef de l’État et le défenseur de la foi chrétienne.
3.  Institutions : gouverner Constantinople
Institutions : gouverner Constantinople

Dans cette Nouvelle Rome, les institutions reprennent le modèle antique. Un préfet urbain (praefectus urbis) remplace l’archonte grec de Byzance. Il contrôle l’administration : sécurité, approvisionnement, justice, travaux publics.
Sous Constance II, le Sénat de Constantinople devient indépendant de celui de Rome. Composé de notables de tout l’Empire, il siège près de l’Augustaion. On peut encore imaginer son emplacement malgré l’absence de ruines visibles.
Pour le visiteur d’aujourd’hui, se tenir sur cette place revient à fouler le sol de l’un des plus puissants centres politiques du monde antique, là où s’articulaient pouvoir impérial, institutions administratives et autorité religieuse.
4.  L’Hippodrome : arène impériale et espace contestataire
L’Hippodrome : arène impériale et espace contestataire
Rejoignons maintenant Sultanahmet Meydanı, autrefois l’Hippodrome. Construit par Septime Sévère, il est agrandi par Constantin. On y célèbre grandes cérémonies publiques, courses de chars et couronnements impériaux.
Son tracé est encore visible sur Google Maps, notamment la sphendonè (partie sud arrondie). Entouré de murs, l’Hippodrome est aussi un lieu d’agitation politique. En 532, il devient le théâtre de la sédition de Nika, une révolte violente contre Justinien (527–565).
Vestiges visibles aujourd’hui :
- la colonne de Théodose, ramenée d’Égypte et installée sur la spina (mur central),
- la colonne serpentine, triple serpent de bronze venu de Delphes, célébrant la victoire des cités grecques contre les Perses à Platées (479 av. J.-C.).
5.  Les forums : réinventer Rome à l’Est
Les forums : réinventer Rome à l’Est
En suivant la Mésè, on croise les grands forums de Constantinople, réinterprétation orientale de l’espace civique romain. Le forum est ici plus qu’une place : c’est un centre religieux, politique et économique.
Le Forum de Constantin, érigé en 328, se présente comme une vaste place circulaire centrée sur une colonne de porphyre : la Çemberlitaş Sütunu (“pierre cerclée”). Elle portait une statue de Constantin en dieu solaire.
Plus loin sur la Mésè :
- le Forum Tauri (ou de Théodose),
- le Forum du Bœuf,
- et le Forum d’Arcadius, dont la base de la colonne est encore visible entre deux immeubles.
Ces forums montrent l’ambition de transposer Rome en Orient, dans un Empire désormais centré sur Constantinople.
En parcourant ces lieux, on mesure à quel point Constantinople incarne le pouvoir impérial tout en affirmant son statut de Nouvelle Rome. Mais pour rayonner durablement, encore fallait-il qu’elle soit peuplée, gérée… et bien alimentée en eau.
 III. Organiser et peupler la capitale
III. Organiser et peupler la capitale
Pour faire de Constantinople une capitale digne de l’Empire, encore faut-il qu’elle ne soit pas qu’un décor impérial. Elle doit fonctionner comme une vraie ville : peuplée, hiérarchisée, administrée, approvisionnée. C’est à cette condition qu’elle incarne une “Nouvelle Rome”, non seulement dans son apparence, mais aussi dans sa vitalité.
1.  Peuplement et politique impériale
Peuplement et politique impériale
Pour asseoir son rang impérial, la ville doit attirer de nouvelles populations, notamment les grandes familles sénatoriales. Ces migrants viennent principalement de Thrace, d’Asie Mineure, d’Italie, et surtout de Rome.
La stratégie de peuplement, essentielle au rayonnement de la ville, mêle mesures incitatives et coercitives selon les empereurs.
- Mesures incitatives : exemptions fiscales, facilités d’installation, annone gratuite instaurée en 332.
- Décision stratégique : détournement du blé égyptien vers Constantinople dès 326, jusque-là destiné à Rome.
- Mesures coercitives : certains groupes, comme les tenanciers des domaines impériaux d’Asie Mineure, sont contraints de construire une maison à Constantinople.
Ces politiques s’avèrent efficaces : dès la mort de Constantin (337), la ville devient une véritable métropole.
 Population estimée
Population estimée
- 337 : env. 100 000 habitants
- Fin IVᵉ siècle : entre 200 000 et 300 000
- VIᵉ siècle : jusqu’à 500 000 habitants (avant la peste)
En 395, après la mort de Théodose Ier, l’Empire romain est divisé. Constantinople devient la capitale de l’Empire romain d’Orient, seul dépositaire légitime de l’héritage impérial. L’Orient se considère comme le véritable cœur de l’Empire avec une ambition durable : réunifier la romanité sous une seule bannière.
2.  Ravitailler Constantinople : l’eau, un défi impérial
Ravitailler Constantinople : l’eau, un défi impérial
Constantinople manque de sources naturelles d’eau douce. Pour répondre aux besoins d’une population croissante, la ville dépend d’un réseau d’aqueducs, de canalisations et de citernes, dont plusieurs sont encore visibles aujourd’hui.
Au-delà de l’approvisionnement quotidien, ces infrastructures ont une fonction stratégique : en cas de siège, lorsque les aqueducs sont coupés, les citernes permettent d’assurer une autonomie en eau. Ce système hydraulique ingénieux est un pilier de la résilience et du prestige de la ville.
 Acheminer l’eau : les aqueducs, artères vitales
Acheminer l’eau : les aqueducs, artères vitales
Les ingénieurs byzantins construisent de longs aqueducs pour capter l’eau à plusieurs dizaines de kilomètres dans l’arrière-pays. Leurs tracés suivent le relief naturel jusqu’au cœur de la cité.
Le plus emblématique est l’aqueduc de Valens, érigé sous Valens (364–378). Même s’il se trouve un peu à l’écart (quartier de Fatih), il incarne l’ambition impériale :
- Approvisionnement estimé à 20 000 habitants,
- Entretien prolongé jusqu’au Moyen Âge,
- Distribution étendue vers les quartiers au-delà de la première enceinte.
La portion la plus visible se situe au début du boulevard Atatürk, après Sarachane Park. Les voitures, minibus et piétons passent encore aujourd’hui sous ses grandes arches. C’est l’un des rares endroits où l’on peut mesurer visuellement l’ampleur de cette infrastructure byzantine.
 Stocker l’eau : les citernes monumentales
Stocker l’eau : les citernes monumentales
La ville développe un vaste réseau de citernes, à ciel ouvert ou souterraines, véritables réservoirs urbains.
- Citerne Basilique (Yerebatan Sarnıcı) : sous Sultanahmet, construite vers 542 sous Justinien, soutenue par 336 colonnes, utilisée pour alimenter le Grand Palais.
- Citerne Philoxénos (Binbirdirek Sarnıcı) : plus calme mais ouverte à la visite.
- Citerne d’Aetius : aujourd’hui Çukurbostan Stadium, immense citerne à ciel ouvert, l’une des quatre grandes de la ville.
- Citerne d’Aspar : au sud de la mosquée Selimiye, construite sous Léon et Zénon.
Certaines citernes étaient connectées à des nymphées : fontaines monumentales où l’eau coulait dans des bassins publics.
 L’eau au quotidien : entre luxe, hygiène et inégalités
L’eau au quotidien : entre luxe, hygiène et inégalités
L’accès à l’eau reflète la hiérarchie sociale. Les élites et le palais impérial ont leurs citernes privées, tandis que les plus modestes dépendent des porteurs d’eau, payés pour livrer à domicile.
Les bains publics sont des lieux essentiels pour l’hygiène et la vie sociale :
- Thermes de Zeuxippe, probablement situés près de l’actuel parc Sultanahmet,
- Sous Constance II, de nouvelles fontaines et bains sont construits pour améliorer la ville et le confort des habitants.
Ce système d’eau, à la fois fonctionnel et prestigieux, fait de Constantinople l’une des capitales les mieux équipées de l’Antiquité tardive.
 IV. Protéger la capitale : fortifications et menaces
IV. Protéger la capitale : fortifications et menaces
1.  La première enceinte de Constantin
La première enceinte de Constantin
Pour protéger la ville qu’il vient de fonder, Constantin fait construire une première enceinte fortifiée, achevée par son fils Constantin II.
Son tracé est aujourd’hui bien identifié, mais il n’en reste plus de vestiges visibles. Cette enceinte délimite les contours initiaux de Constantinople, mais la croissance rapide de la ville rend ses limites rapidement obsolètes : dès la fin du IVᵉ siècle, une grande partie de la population vit déjà au-delà de ces premiers murs.
2.  Les murailles de Théodose II
Les murailles de Théodose II
Un tournant majeur a lieu sous le règne de Théodose II (408–450). À cette époque, la ville est en plein essor démographique et doit faire face à de nouvelles menaces, en particulier les incursions des Huns.
La première enceinte théodosienne est construite en 413, mais endommagée par un séisme. En 447, face à l’urgence, elle est rapidement reconstruite et doublée en seulement deux mois.
Ce système défensif, composé de deux murs successifs, d’une large douve et de portes monumentales, reste l’un des plus impressionnants de l’Antiquité.
C’est aussi à cette période que la Porte Dorée est achevée, au sud-ouest de la ville : elle devient un symbole d’entrée triomphale dans la capitale.
Ces murailles jouent un rôle central dans la protection de la cité : pendant près de mille ans, elles permettent à Constantinople de résister à de nombreuses attaques et de conserver son statut de bastion impérial.
3.  La Chora : entre ville et campagne
La Chora : entre ville et campagne
Entre l’enceinte de Constantin et celle de Théodose, une zone intermédiaire se développe progressivement : la Chora, un mot grec signifiant « la campagne ».
Longtemps peu habitée, elle accueille quelques noyaux de peuplement, comme :
- Psamathia (aujourd’hui Samatya),
- Deutéron, situé près de la porte d’Anatolie,
- ou encore les Blachernes, qui deviendront au Moyen Âge un quartier impérial.
Cette zone montre comment la ville déborde progressivement de ses limites fondatrices, à mesure que sa population et son influence s’étendent.
4.  Le Long Mur d’Anastase Ier
Le Long Mur d’Anastase Ier
Sous le règne d’Anastase Ier (491–518), un nouveau projet défensif voit le jour : le Long Mur, une ligne fortifiée bâtie à environ 70 km à l’ouest de la ville, entre la mer de Marmara et la mer Noire.
L’objectif est clair : créer une première ligne de défense pour ralentir les incursions des Huns, des Slaves et des Bulgares, avant qu’ils n’atteignent les abords immédiats de la capitale.
Moins efficace que les murailles urbaines, ce mur témoigne néanmoins de l’ampleur des efforts byzantins pour anticiper les menaces et défendre leur centre politique.
 Conclusion : Naissance d’un Empire urbain
Conclusion : Naissance d’un Empire urbain
Cette balade dans la Constantinople des origines montre combien la ville est le fruit d’un projet politique réfléchi et ambitieux.
Pensée comme une Nouvelle Rome, elle devient non seulement une capitale impériale, mais aussi une vitrine de la puissance byzantine.
Sous Constantin et ses successeurs, l’urbanisme, les institutions, les infrastructures et les monuments forment un tout cohérent, destiné à affirmer l’unité de l’Empire et à projeter son autorité vers l’Orient.
À travers ses forums, ses citernes, ses murailles et ses palais, Constantinople incarne une forme d’idéal impérial — entre continuité romaine et nouvelles ambitions chrétiennes.
Pensée pour durer, la ville ne cesse de s’adapter et de se réinventer. Et c’est peut-être là sa plus grande réussite : avoir traversé les siècles, sans jamais cesser d’être un centre du monde.